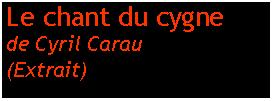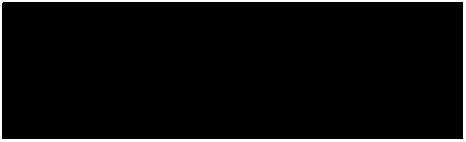
|
Les Éditions de La Frémillerie |
|
Rielo fit la connaissance ce soir-là de Massimo Gramsçi avec la ferme intention de le descendre. L’homme n’était guère plus âgé que lui : trente-deux ans, trente-trois peut-être. D’un mouvement auguste, grand seigneur, il invita Rielo à le rejoindre à sa table. Gramsçi ne paradait pas ; il était naturellement munificent. L’arrogance tranquille de son air ne provenait pas de son insouciance rieuse ou d’un mépris pour la médiocrité, non. Cela se laissait deviner en filigrane de certains gestes, sa manière de tenir son clope ou d’appeler une serveuse ou d’acquiescer à une parole. Cet homme-là était un prédateur, d’un autre âge peut-être, d’un autre lieu ? Il était châtain et ses yeux d’un noisette si clair qu’on les croyait d’or blanc au premier abord. Ses pommettes saillantes, son nez en bec d’aigle, long, ses lèvres épaisses, son menton massif concouraient à le rendre inquiétant et beau en même temps, mais d’une beauté virile et sombre où toute aptitude à la compassion aurait été gommée dès le plus jeune âge. Ses premières paroles après que Rinelli eût fait les présentations furent : — Alors tu y étais ? Rielo ne demanda pas où. Il savait pertinemment à quoi Gramsçi faisait allusion. — Oui, dit-il avec sérénité. Cela suffisait. Rielo, dès que leurs regards s’étaient croisés, avait su que l’homme montant de la pègre italo-américaine avait été un doughboy qui avait connu le froid, le feu et la boue dans l’Argonne ou le bois de Belleau. Il était de ceux que plus tard on appela « la génération perdue ». Quelle connerie ! La guerre avait sauvé Gramsçi ; elle l’avait révélé à lui-même, à son instinct, à cette palpitation de tempête, de furie latente qui grondait sans vraiment dire son nom. Tout le reste était un ramassis de pleurnicheries dans lequel il ne pouvait pas se reconnaître. Il n’était pas un ancien combattant désabusé, marqué dans sa chair, castré comme tant de pauvres types qui erraient encore dans les rues de Paris pareils à des flâneurs ivres de haschich. Il était rentré aux States, lui, pour s’emparer de tout ce qui lui revenait de droit. Massimo Gramsçi sentait le sang, le soufre et l’inéluctable, tandis que les cris de douleur et de pitié de ses ennemis l’auréolaient d’un voile noir. Rielo le voyait bien, une lueur fixe, dingue, hantait l’iris translucide de cet homme — cette lueur qu’on pouvait surprendre chez le capitaine Gianotti. Gramsçi, en retour, voyait la même chose dans les yeux d’Usaï. D’instinct, ils se prirent d’amitié.
|
|
LF |